
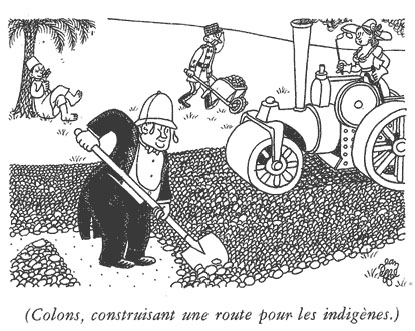
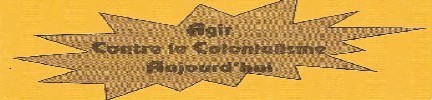
Le candidat Sarkozy
avait
fait du mot « rupture » un slogan
de sa campagne électorale. On sait,
depuis qu’il a été élu
à la Présidence de la République, que
le vocable ne
signifie pas autre chose que l’accentuation
de la même politique rétrograde au
service des puissants et des
privilégiés poursuivie jusque-là. Une
politique à
laquelle, en tant que
ministre, il avait
déjà lui-même
largement contribué et dans son
sens le
plus négatif. La
constatation est
encore plus évidente
quand on entend le
même s’exprimer sur les questions
léguées par la domination coloniale et les nouveaux rapports qui
devraient
s’établir entre
la France et les pays
nouvellement indépendants.
Pour
ce qui est de l’Algérie, près de
cinquante ans après la fin
d’une guerre dont les terribles traces
ne sont pas encore effacées,
il
paraissait grand temps à la majorité des
Français de signer ce
traité de paix et d’amitié que, les deux peuples
souhaitent depuis
longtemps. Mais, avant même de s’installer
à l’ Elysée, Nicolas
Sarkozy en avait déjà rejeté
l’idée, déclarant
que « l’amitié
n’avait pas
besoin d’être gravée dans le marbre
d’un traité ». Il
n’en est donc
plus question. C’est dans le même esprit
qu’il s’adressait aux Africains dans
son discours de Dakar. Il y révélait
une incroyable
ignorance des
réalités historiques faisant appel, en
plus, à tous les poncifs du colonialisme pour tenter de
justifier la mise
en tutelle du continent. Ignorées,
les raisons véritables des conquêtes,
ignorés les massacres, les travaux
forcés, le vol des terres, la destruction des anciennes
cultures et
civilisations, le racisme et les inégalités de
traitement
institutionnalisés !
Faut-il s’en
étonner de la part d’un homme dont
de
multiples déclarations
n’ont pas manqué
d’exalter le « rôle
positif de la colonisation » ?
Les
véritables porte-parole
des peuples africains,
contrairement à ce qu’en attendaient Nicolas
Sarkozy et ses conseillers ont
vivement réagi à ce discours, ressenti comme une
provocation. L’historien
camerounais Achille M’Bembe interviewé par un
journaliste pour commenter les
propos du Président résumait ainsi leurs
pensées :
« Sarkozy
invente une Afrique fantôme... Une Afrique imaginaire
peuplée de mythes sortis
tout droit du bréviaire raciste du XIXème
siècle... Nous ne voulons pas revenir
à ce genre de vision du monde qui a servi à
légitimer la colonisation »...Le
même observait
en outre que « depuis
1960, la France
soutient systématiquement en Afrique les régimes
les plus corrompus et qui se
sont le plus investis dans la destruction de leurs peuples :
au Gabon, au
Cameroun, au Togo, au Congo et ailleurs »…
Nous savions nous aussi que, ce n’est pas sur la « bonne volonté » et « l’esprit d’ouverture » de Sarkozy et de ceux qui l’entourent qu’il faudrait compter pour qu’enfin s’ouvre un nouveau chapitre des relations entre la France et les peuples si longtemps subjugués mais avant tout sur l’union de tous les anticolonialistes où qu’ils se trouvent en Afrique ou en Europe. C’est à cela que, pour sa part, l’ ACCA contInuera d’œuvrer .
Henri ALLEG, octobre 2007
Sarkozy sur les traces
de « Tintin en
Afrique »
« En s’adressant le 26 juillet dernier aux universitaires et étudiants réunis à l’université Cheickh Anta Diop à Dakar, Sarkozy a tenu des propos scandaleux, provocateurs, qui ont été reçus comme une insulte un peu partout dans le continent africain. Passe encore qu’il refuse l’idée de « repentance » à propos de l’époque coloniale : nous rejetons aussi ce concept d’origine religieuse, parce qu’il n’y a pas de culpabilité collective d’un peuple français ou allemand pour les crimes que certains de ses citoyens ont commis. Mais il est inacceptable de reparler des « côtés positifs » de la colonisation à ceux qui l’ont subie : on ne peut établir en 2007 de relations amicales, solidaires, sur un pied d’égalité avec les peuples d’Afrique en niant la réalité historique, les dimensions criminelles du système colonial : l’esclavage autrefois et le travail forcé son succédané jusqu’en 1946, les tortures et les massacres des conquêtes et répressions coloniales, la domination politique, militaire, diplomatique de notions niées, et plus encore l’exploitation par les banquiers et industriels de la « métropole » des richesses minières, énergétiques ou agricoles du pays colonisé. Le système colonial perpétue le sous-développement de la colonie, dont le rôle se limite à fournir, à bas prix, des matières premières aux usines de la « métropole » industrialisée.
En ce sens, le système d’origine coloniale est toujours actuel, car, en 2007, le monde est toujours partagé en « pays du sud » fournisseurs de matières premières mis dans l’incapacité de s’industrialiser, au profit des financiers et affairistes des grandes puissances industrielles et commerciales. Ce système « mondialisé », financier, militaire, a ses politiciens, ses idéologues dont Sarkozy et ses amis de l’UMP.
Mais ne nous y trompons pas ; certains d’entre eux ne relèvent pas de la droite : P. Lamy, président de l’OMC dont le rôle est d’écraser les produits des pays du sud par la concurrence du marché mondial, Strauss kahn qui dirige le FMI, imposant la loi financière des grandes puissances aux pays démunis sont toujours d’éminents membres du P. S. français. Bernard Kouchner se dit toujours de gauche à la tête du Quai d’Orsay alors qu’il est le théoricien mondial du « droit d’ingérence » des grandes puissances dans les pays du sud : les prétextes « humanitaires » ont beaucoup servi aux puissances coloniales depuis deux siècles, Kouchner n’a rien inventé quand il nous menace d’une intervention militaire française au Soudan, après le Tchad, l’Afghanistan, où sont déjà nos troupes. Cela en parfaite harmonie avec le président Sarkozy qui, à Dakar, a défini « les Africains » comme il y a 60 ans le faisait le dessinateur belge Hergé dans « Tintin au Congo » ; selon Tintin et Sarkozy ils seraient toujours ces grands enfants inachevés condamnés par leur nature à ne pas se développer, si d’autres (les blancs ?) ne prennent pas leur destin en main à leur place ; quelques phrases de Tintin-Sarkozy à Dakar, grandiloquentes, sont d’ahurissantes bêtises : « L’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire. [Le paysan ] est resté immobile au milieu d’un ordre immuable où tout semble être écrit d’avance […]. Jamais [il] ne s’élance vers l’avenir. Jamais il ne lui vient à l’idée de sortir de la répétition pour s’inventer un destin »
« L’Afrique a réveillé les joies simples, les bonheurs éphémères et ce besoin, ce besoin auquel je crois moi-même tant, ce besoin de croire plutôt que de comprendre, ce besoin de ressentir plutôt que de raisonner ».
« Le colonisateur est venu, il a pris, il s’est servi, il a exploité (…), il a dépouillé le colonisé de sa personnalité, de sa liberté, de sa terre, du fruit de son travail. Il a pris mais je veux dire avec respect qu’il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Ils croyaient briser les chaînes de l’obscurantisme, de la superstition, de la servitude ».
Face au retour en force du passé colonial à la tête de l’état français, ne serait-il pas temps de construire en France un front de résistance anticolonialiste et anti-impérialiste ? La diversité de nos organisations respectives n’est pas un obstacle, nous avons un idéal d’égalité entre les hommes et les peuples, que Messieurs Sarkozy et Kouchner ne partagent pas.
(Résumé de son intervention au stand
de l’ACCA, Fête de l’Humanité
, 16
sept.2007)
« Maintien de l’ordre » et poursuite du pillage colonial
Afin de préserver son avenir, le colonialisme a besoin de truquer son
histoire. C’est le sens de la loi de février 2005, dont le but était de
trouver une justification au pillage des pays asservis par la métropole.
A peine élu, la Président Sarkozy est allé confirmer au Sénégal que la
France refuserait toute autocritique sur de sujet .Selon lui, on aurait
donc eu une période d’assistance (la période coloniale) et une période
de coopération ( la période post-coloniale, de 1962 à 2007)…
Depuis 1962, les armées françaises sont intervenues en action de combat
vingt huit fois de manière officielle sur le sol et dans les airs de douze
pays indépendants d’Afrique. Quel que soit le type et le niveau de
l’intervention militaire ( on peut en distinguer trois), l’objectif est
toujours le même : installer ou consolider une présence menaçante destinée
à protéger les intérêts de quelques très grandes entreprises françaises
opérant sur place. Des milliers d’Africains ont été tués au cours de ces opérations.
1. Les actions de «maintien de l’ordre» ou de «défense
de l’état de droit» n’ont été que des opérations de répression dirigées
contre des mouvements populaires : Sénégal, 1962 ; Gabon, 1964 ; Tchad,
1968-72 ; Zaïre, 1977 ;Togo, 1986 ; Gabon, 1990 ; Rwanda, 1990 ;
Centrafrique, 1997).Elles ont été très violentes et ont toutes abouti à
la remise en place, pour longtemps, de «régimes amis» qui ont permis au
pillage colonial se perpétuer bien après les indépendances.
2. Les opérations de «sauvetage et d’exfiltration», toujours systéma-
-tiquement surdimensionnées, ont permis à chaque fois, sous le couvert
«humanitaire», d’installer durablement des corps expéditionnaires de
«surveillance» et «d’appui» : Mauritanie, 1977 ; («Lamantin») ; Zaïre, 1978
(la fameuse action sur Kolwési) ; 1983 ; Rwanda, 1990-93 («Noroît») ;
1997 et 1998, Congo («Pélican», «Antilope», «Malachite») ; Côte d’Ivoire,
2002 («Licorne 1»).
3. Les «actions d’interposition au service de la paix» ont systéma-
-tiquement permis d’installer de manière définitive des bases stratégiques
considérables ( de 2000 à 5000 hommes) : Tchad, 1978 «Tacaud») ; Tchad, 1983,
1986 («Manta», «Epervier») ; Erythrée, Ethiopie, (1991, 1999) ;
R.D.C., 2003 («Artémis»). Côte d’Ivoire, 2004 («Licorne 2»).
En 2007, la France entretient un corps expéditionnaire réparti sur plus de
dix pays d’Afrique . Forte de plus de 10 000 hommes, cette armée coloniale
tient en respect les peuples de la région et constitue, sous couvert
humanitaire et pacifique, un frein à leur progrès politique et à leur
libération économique.
Afin de participer à la prise de conscience de la perpétuation de la
violence coloniale, nous pourrions demander par exemple à nos députés
de demander des comptes , dans le cadre des « questions au gouvernement »,
et appuyer toutes les initiatives anticolonialistes demandant le
démantèlement des bases et le retour immédiat de tous les personnels
militaires. Ne serait-ce pas un moyen de faire des économies,
puisqu’il en est question si souvent ?...
Résumé de son Intervention au
stand de l’ACCA, Fête de l’Humanité,( 16.09.07)
INDOCHINE-ALGERIE : DU
BON USAGE
COLONIAL DU NAPALM
Etre
un historien de la guerre dite
« française »
d’Indochine est parfois un peu lassant… On a trop
souvent l’impression de révéler
des
faits connus, certes, de la (petite) communauté des
spécialistes, mais
découverts avec stupéfaction par des gens
pourtant par ailleurs curieux et même
érudits.
Il
faut donc rappeler,
lapalicissadement mais inlassablement, qu’avant la guerre
d’Algérie
(1954-1962), il y eut la guerre d’Indochine (1945-1954),
qu’avant le 1 er
novembre 1954 (Toussaint des Aurès) il y eut… le
7 mai 1954 (choc de Dien Bien
Phu).
C’est
à cette prééminence
chronologique, dont les peuples de la région se seraient
bien passés, que
l’Indochine doit son statut de
« laboratoire » de
l’Algérie.
Il
y a quelques années, avec le débat
sur le drame de l’usage de la torture lors de la guerre
d’Algérie, nous avons
été quelques-uns à rappeler que bien
des officiers gégéneurs (nous avons les
noms) qui s’étaient tristement
illustrés, lors du conflit franco-algérien,
avaient fourbi leurs armes sur les rives du Fleuve rouge ou dans la
jungle
indochinoise. Ce qui ne signifie évidemment pas que
l’étendue de cette gangrène
fut la même dans les deux conflits.
La sortie du film L’Ennemi intime, de Florent Emilio Siri, sur un scénario de Patrick Rotman, a amené bien des journalistes, bien des observateurs et, bientôt, le grand public, à découvrir avec horreur que la napalm, cette essence gélifiée qui portait la mort enflammée, fut une arme utilisée lors du conflit franco-algérien. Certains ont même ajouté : finalement, nous avions fait la même chose en Algérie que, plus tard, les Américains au Vietnam.
Mais
la terre vietnamienne n’a pas
attendu les sinistres B.52 US pour connaître
l’horreur du napalm. Il y a bien
longtemps que ses fils avaient reçu cet enfer du ciel,
lancé par des avions…
français.
Prévert,
peut-être le premier, avait
lancé un cri d’alarme, dès
1953 :
« Cependant
que très loin on
allume des lampions
des lampions au napalm sur de
pauvres
paillotes
et des femmes et des hommes des
enfants
du Vietnam
dorment les yeux grands ouverts
sur la
terre brûlée… »[1]
Et
c’est l’un des héros de la saga
militaire française du XX è siècle, le
général (fait maréchal à
titre posthume)
de Lattre qui a été le père de cette
utilisation. Père honteux ? Père
caché ? Non pas.
De
Lattre est nommé commandant en chef
du Corps expéditionnaire français en Indochine le
6 décembre 1950, au lendemain
d’un premier désastre, dit de
la RC 4
(route Cao Bang-Lang Son), au nord-Tonkin.
Ses premières instructions, début janvier 1951,
rapportée avec ferveur par
Lucien Bodard, sont les suivantes : « … que toute la
chasse y soit, que cela
mitraille, que cela bombarde. Du napalm, du napalm en masse ;
je veux que,
tout autour, ça grille les Viets »[2] (on ne disait pas, alors, Vietnamiens,
c’eût été trop
d’honneur,
pour nommer l’adversaire).
Il
n’a pas à attendre longtemps. Dès la
mi-janvier, un nouveau choc a lieu avec
les troupes Viet Minh, près de Vinh Yen, toujours au Tonkin. S’il faut donner une
date d’apparition du napalm au
Vietnam, c’est donc celle-ci : 15 janvier 1951 (nous
sommes donc huit
années pleines avant l’intrigue de l’Ennemi
intime). Le correspondant du Monde,
Charles
Favrel, décrit alors le spectacle : « La
bataille fait rage. Les “King Cobra“ et les
“Hélicat“ rasent les crêtes,
et le
terrifiant napalm anéantit une brigade
ennemie »[3]. Terrifiant : Favrel a
utilisé le
mot approprié. Il suffit de lire les Mémoires des
combattants vietnamiens
d’alors, lorsqu’ils découvrirent les
effets du napalm, pour en être convaincus.
Là
où Favrel a du mal à cacher son horreur, Bodard,
toujours lui, ne peut masquer
une certaine jubilation :
« Tout à coup
jaillit une énorme boule
de feu, un soleil couleur de corail. On dirait qu’elle sort
de la terre
elle-même, mais elle dégringole vers le bas, elle
se répand comme une nappe sur
tout un flanc. En quelques secondes, tout est embrasé, tout
est léché par une
langue de feu ; et puis il ne reste plus que des colonnes
d’énormes fumées
grasses et noires. Il n’a pas fallu une minute pour que la
“chose“ brûle la
colline entière – et alors je comprends.
C’est le napalm. Je viens d’assister à
son premier jet, à la première mousson du liquide
incandescent en Indochine
(…). Maintenant le napalm règne sur tout le
paysage – volutes rouges et
tourbillons noirs. C’est comme si de monstrueuses
orchidées de mort avaient
fleuri partout. Les crêtes surtout ne sont plus que des tas
d’incandescence. Et
les bouffées de vent apportent l’odeur du
cramé. Là où il y avait la nature,
dans sa verdoyance, il ne reste plus que des taches
calcinées où plus rien ne
brûle, ou même plus rien ne fume – la
paix du feu. Je redescends encore une
fois du mirador. Les aviateurs, à leurs micros, clament que
les flammes ont
couru plus vite que les Viets, elles en ont rattrapé et
englouti des centaines,
des milliers peut-être. Ils ont vu des hommes
s’enfuir et être happés par
derrière – ils continuaient encore à
courir quelques mètres, torches vivantes
qui s’éteignaient en quelques
secondes »[4].
Dès
lors, cet usage ne cessera plus. A chaque fois que le Corps
expéditionnaire fut
en difficulté – et il le fut de plus en plus
– le napalm fut l’arme suprême.
Jusque et y compris à Dien Bien Phu.
Ce
qui n’arrêta évidemment pas le cours des
choses.
Mais
il n’est pas inutile de rappeler à cette France en
voie de sarkoïsation, fière
de ses valeurs, fière de son passé colonial, que
le feu tricolore tua souvent
et marqua bien des
peaux indigènes.
[1]
Poème de 1953, in La pluie et le beau temps,
Paris, Gallimard,
Coll. Le Point du Jour, 1955
[2]
Instructions données au général
Hartemann, commandant en chef de
l’aviation du corps expéditionnaire ; cité par Lucien Bodard, La
guerre
d’Indochine, Vol. IV, L’Aventure,
Paris,
Gallimard, 1967
[3]
22 mars 1951.
[4]
Ouvrage cité.
Jean-Philippe Ould Aoudia 22 octobre 2007
COMMUNIQUE DE PRESSELa lecture lundi 22 octobre 2007 de la lettre de Guy Môquet, fusillé par les nazis, est à mettre en parallèle avec la lecture lundi 18 mars 1962 de la lettre du ministre de l’Éducation nationale de l’époque dans toutes les écoles de France.Celui-ci entendait associer l’Université française au deuil lié à l’assassinat, par l’OAS, trois jours auparavant, de six fonctionnaires de l’Éducation nationale : « …Unis dans le sacrifice comme ils l’étaient dans leur œuvre d’éducation, ils doivent le demeurer dans notre souvenir ».
La décision de rappeler, aujourd’hui, le souvenir du sacrifice de Guy Môquet serait moins ambiguë si, par ailleurs, le pouvoir politique n’apportait pas sa caution à ces nostalgiques de l’Algérie coloniale qui honorent et justifient, aujourd’hui, les assassins des Inspecteurs des Centres sociaux éducatifs : « morts au champ d’honneur de leur travail…victimes de leur engagement pour les valeurs de la République ».
Pour nous contacter, cliquez ici !
| Site
hébergé par NetAktiv |
Copyleft "Ppeuples libres" 2006‚ tous droits réservés |
Remerciements www.le site du zéro |
Site Optimisé pour Mozilla FIREFOX 1.5 pour TOUS les navigateurs ! |