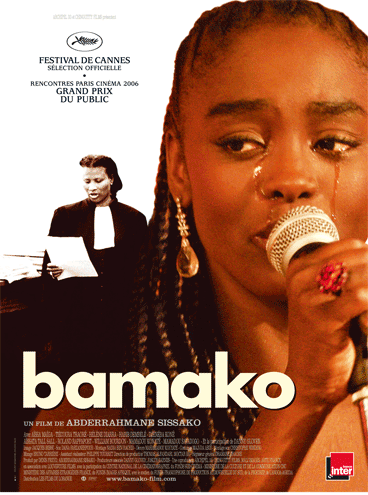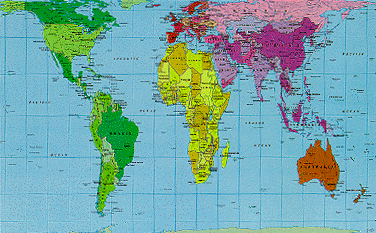par
Numancia Martínez
Poggi.
Le carrefour du
Général Jacques PÂRIS de BOLLARDIERE
a été inauguré
le 29 novembre à Paris.
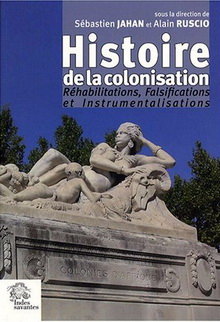 Histoire
de la colonisation : Réhabilitations, Falsifications et
Instrumentalisations
Histoire
de la colonisation : Réhabilitations, Falsifications et
Instrumentalisations
Sous la direction de
Sébastien Jahan & Alain Ruscio
Contributions de Sidi
Mohammed Barkat, Anissa
Bouayed, Michele Brondino, Catherine Coquery-Vidrovitch, Philippe
Dumont, Vincent Geisser, Mohammed Harbi, Sébastien Jahan,
Gilles
Manceron, Gilbert Meynier, Rosa Moussaoui, François Nadiras,
Jean-Philippe Ould-Aoudia, Mickaëlla Perina, Delphine
Robic-Diaz,
Alain Ruscio, Odile Tobner, Trinh Van Thao, Jan Vandersmissen.
La France du
début du XXI è
siècle a la fièvre… post-coloniale.
Aussi
étonnant que cela puisse paraître – et
que cela
paraîtra aux historiens de l’avenir – le
débat
sur « l’œuvre de la France outre-mer
» a
été réactivé et a de
nouveau
enflammé les passions. Une loi de février 2005
–
heureusement amputée de son aspect le plus choquant par la
suite
– a prétendu imposer aux historiens, mais aussi au
public,
une lecture unilatérale de l’histoire coloniale
française.
Epiphénomène
? Non point, affirment
les auteurs de ce livre, historiens, philosophes, politologues,
journalistes, responsables associatifs… Il y a bel et bien
un
retour de l’esprit colonial, illustré par mille et
un
autres petits et grands faits de la vie politique contemporaine, de la
réhabilitation de certains tueurs OAS au discours de Dakar
(juillet 2007), de l’insulte contre les harkis («
sous-hommes ») à l’exaltation
d’une
identité nationale que certains rêvent blanche et
chrétienne. lire
la suite
APPEL DE PERPIGNAN
le 7 novembre 2007
Alors que le discours sur les bienfaits de
la
colonisation semble être revenu à la mode, tout ce
que la France compte
de nostalgiques de l’Algérie française
et d’apologistes du colonialisme
lève la tête. Divers projets
s’inscrivent plus ou moins dans cette
perspective, tel le Mémorial national de la France
d’outre-mer annoncé
à Marseille, le Musée de l’histoire de
la France en Algérie à
Montpellier, et à Perpignan un Centre de la
Présence Française en
Algérie.
Le projet le plus avancé, celui de Perpignan, devrait ouvrir
ses portes en 2008...
Samedi
17 novembre à Gentilly
Journée de
solidarité avec la Palestine.
Dimanche
27 octobre à Bagnolet :
Journée anti-colonialiste et
anti-impérialiste
à l’occasion du 42ème anniversaire de
l’assassinat de
Mehdi BEN BARKA
intervention du président
de l'ACCA : Henri
Alleg
http://www.lariposte.com/Le-28-octobre-a-Bagnolet-journee-anti-colonialiste-912.html
http://paris.indymedia.org/breve.php3?id_breve=6862
http://www.demosphere.eu/node/3965
http://iso.metric2.free.fr/www/spip.php?article233
http://www.indigenes-republique.org/spip.php?article1055
http://www.survie-paris.org/
http://www.communautarisme.net/index.php?action=agregateur&=
A G I R
Contre le
Colonialisme Aujourd'hui
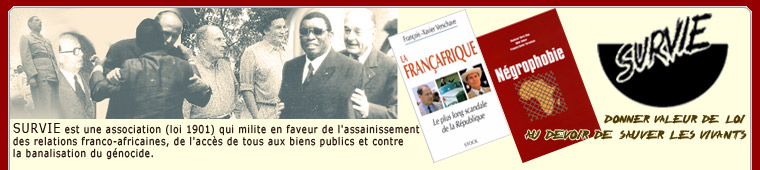
le site de l'association
SURVIE
ou cliquer sur le bandeau. http://survie-france.org/
Nota
:
Le Président de la
République,
Nicolas Sarkozy, a demandé aux enseignants
d’Histoire de lire à leurs
élèves,
ce 22 octobre, la dernière lettre de Guy Môquet,
fusillé le 22 octobre 1941.
Les réactions des enseignants ont été
diverses.
Pour
ma part, j’ai saisi cette
occasion pour rappeler – et sans doute pour apprendre
à beaucoup – que, ce même
jour, un Vietnamien avait lui aussi versé son sang pour la
France.
Le
22 octobre, je lirai la lettre de
Huynh Khuong An… pas à mes
élèves, puisque j’ai quitté
l’enseignement il y a
bien des années. Mais,
oui, je lirai la
lettre de Huynh Khuong An, un patriote vietnamien, un communiste
français et
vietnamien. A mes proches, à mes amis et même,
tiens, aux participants des VII
è Assises de la Coopération franco-vietnamienne
qui commenceront, heureuse
coïncidence, précisément ce 22 octobre,
à Montreuil.
Huynh
comment ? Peu de Français,
peu d’historiens, peu de ses camarades de Parti connaissent
son nom.
Il a
pourtant avec Guy Môquet deux
points, au moins, en commun : il était communiste
et il a été fusillé à
Châteaubriand, comme otage, le 22 octobre 1941. Il
était, par rapport au jeune
Guy, un vieux. Pensez
donc : il
avait 29 ans !
Né
à Saigon, dans ce Vietnam que les
colonialistes s’obstinaient alors à appeler Indochine,
il était venu en France, à Lyon, pour y
poursuivre des études. Qu’il
réussit brillamment, au point de devenir professeur
stagiaire de français. Non
sans s’investir à fond dans la vie politique
française. Membre du PCF,
Secrétaire des Etudiants communistes de la région
lyonnaise, il milite
beaucoup, en particulier au sein des Amis
de l’Union soviétique aux
côtés de son amie et compagne Germaine Barjon. En
1939, après l’interdiction du PCF, il participe
à la vie clandestine de son
Parti.
Nommé
au lycée de Versailles, c’est là
qu’il est arrêté (les sources
divergent : en mars ou en juin 1941), puis
envoyé à Châteaubriand. Le suite,
terrible, est connue.
Voici
sa lettre :
« Sois
courageuse, ma chérie. C’est sans aucun doute la
dernière fois que je t’écris.
Aujourd’hui, j’aurai vécu. Nous sommes
enfermés provisoirement dans une baraque
non habitée, une vingtaine de camarades, prêts
à mourir avec courage et avec
dignité. Tu n’auras pas honte de moi. Il te faudra
beaucoup de courage pour
vivre, plus qu’il n’en faut à moi pour
mourir. Mais il te faut absolument
vivre. Car il y a notre chéri, notre petit, que tu
embrasseras bien fort quand
tu le reverras. Il te faudra maintenant vivre de mon souvenir, de nos
heureux
souvenirs, des cinq années de bonheur que nous avons
vécues ensemble. Adieu, ma
chérie. »
Il y
a, à Paris, au père Lachaise, un
monument érigé aux martyrs de
Châteaubriand. Sous le nom de Huynh Khuong An,
une simple mention, d’ailleurs anachronique : Annamite.
Je
livre cette courte évocation à la
réflexion. Et si la présence d’un
immigré,
d’un colonisé, aux côtés des
martyrs
français,
était un clin d’œil de
l’Histoire ? Et si elle prenait valeur de
symbole ? Le régime de
Vichy, qui a livré les otages, ou les nazis, qui les ont
fusillés, ont très
certainement considéré avec mépris cet
étranger venu se mêler aux terroristes.
Lui ont-ils demandé de
prouver, par son ADN, le droit de mourir pour la France ?
Je
ne suis pas partisan du boycott de
la lecture de la lettre de Guy Môquet. Mais lisons
également, comme en écho,
comme en réponse à la xénophobie qui
(re)pointe son mufle, celle d’un
Vietnamien, un étranger et notre
frère
pourtant.
Jean-Philippe
Ould Aoudia 22 octobre 2007
COMMUNIQUE DE PRESSE
La lecture
lundi 22 octobre 2007 de la lettre de Guy Môquet,
fusillé
par les nazis, est à mettre en parallèle avec la
lecture lundi 18 mars 1962 de la lettre du ministre de
l’Éducation
nationale de l’époque dans toutes les
écoles de
France.
Celui-ci
entendait associer l’Université
française au deuil
lié à l’assassinat, par
l’OAS, trois jours
auparavant, de six fonctionnaires de l’Éducation
nationale : « …Unis
dans le sacrifice comme
ils l’étaient dans leur œuvre
d’éducation, ils
doivent le demeurer dans notre souvenir ».
La décision
de rappeler, aujourd’hui, le souvenir du sacrifice de Guy
Môquet
serait moins ambiguë si, par ailleurs, le pouvoir politique
n’apportait pas sa caution à ces nostalgiques de
l’Algérie
coloniale qui honorent et justifient, aujourd’hui, les
assassins
des Inspecteurs des Centres sociaux éducatifs :
« morts
au champ d’honneur de leur travail…victimes de
leur engagement
pour les valeurs de la République ».
 La leçon d’Henri
Alleg
La leçon d’Henri
Alleg
au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers
Face
à trois classes de terminale, l’ex-journaliste et
historien est venu témoigner de son expérience de
lutte
et de résistance contre le colonialisme et pour
l’indépendance de l’Algérie.
Il y a un mois, les
élèves ont vu la pièce de
théâtre la Question, mise
en scène par François Chattot au
Théâtre national de Chaillot. Ils ont
bien sûr lu le livre d’Henri Alleg. Et, lundi
dernier, veille du 1er
mai, ils l’accueillaient en personne juste après
la projection du film
de Laurent Heynemann (1977), adaptation de la Question. Jack Ralite,
sénateur et ancien maire d’Aubervilliers, a fait
le déplacement pour
assister à cette rencontre. À
l’arrivée d’Alleg, accompagné
de
Mme Parquier, proviseure du lycée Le Corbusier, et
de Catherine Robert,
professeure de philosophie, à l’initiative de ce
projet en plusieurs
épisodes, les élèves se
lèvent.
Sofia prend le micro pour souhaiter la bienvenue.
« C’est un honneur. Je voulais vous
remercier d’être présent parmi
nous. Nous sommes très contents... »
Émue, Fatima l’est aussi, qui a la
lourde tâche de formuler la première
question : « On aimerait.... (
lire la suite)
 L'ACCA vous invite
L'ACCA vous invite
à signer la pétition
pour les COMORES.
lien sur le site de http://www.sos-comores.org/index.html
Lucie AUBRAC
L’anticolonialiste
Par Alain Ruscio, historien. in
l'Humanité 17/03/2007
À l’occasion des
hommages nombreux qui seront rendus à Lucie Aubrac,
les projecteurs seront surtout braqués - et c’est
bien naturel - sur
son action héroïque durant la Seconde Guerre
mondiale. Mais sa vie
citoyenne ne s’est pas achevée au moment de la
capitulation de la bête
immonde du nazisme.

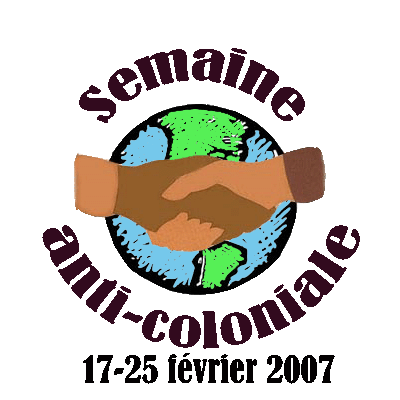

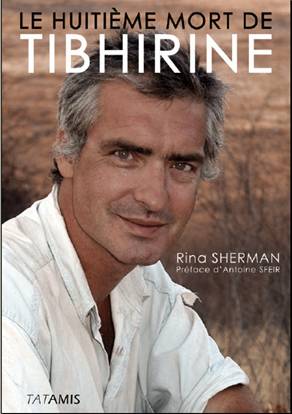
Victime d’une
campagne calomnieuse sans précédent, en
février 2004, le grand reporter Didier Contant fait une
chute mortelle
d’un immeuble parisien alors qu’il
s’apprêtait à publier son
enquête
sur la mort des moines de Tibhirine en Algérie en 1996. Les
résultats
d’un long travail d’investigation sur le terrain
à Blida par l’ancien
rédacteur en chef de l’agence Gamma confirment que
les moines ont été
enlevés et assassinés par le GIA (Groupe
Islamiste Armé).
Mais à Paris, des
confrères affirment auprès des
rédactions parisiennes que Didier Contant travaillait pour
les services
français et algériens dans le cadre de son
enquête sur les moines,
déconseillant toute publication de son investigation. Ces
lobbies,
composés de journalistes, d’éditeurs,
d’avocats et d’organisations de
droits de l’homme, brandissent le témoignage
d’un sous-officier
transfuge de l’armée algérienne,
tendant à prouver l’implication de
l’armée dans le rapt des moines. Didier Contant
vivait cette campagne
calomnieuse comme une catastrophe professionnelle ;
dépossédé de son
honneur, de sa dignité et de la capacité de
gagner sa vie, il ne put
l’accepter.
Rina Sherman livre un
témoignage saisissant sur la mort
de son compagnon, Didier Contant. Pour rendre hommage à
l’homme qu’elle
a aimé, elle raconte avec brio leur grande histoire
d’amour et la
tragédie qu’ils ont vécues. Son
récit se lit comme un roman, comme un
thriller, dans lequel suspense, investigation et combat se confondent
dans une réflexion essentielle : il ne faut pas se taire
afin que soit
respecté l'un des droits fondamentaux de l’homme,
la liberté
d’expression.
Exilée d’Afrique du
Sud en 1984, Rina Sherman, cinéaste
et anthropologue, a fait ses études avec Jean Rouch avant
d’effectuer
une étude ethnographique sur les Ovahimba en Namibie et en
Angola. Elle
vit à Paris.
Conception graphique : Jophan
ISBN : 978-2-9523647-4-4
Prix : 19,90€
Décès
de
Gaston DONNAT
- article de l
'Humanité
du 8 février 2007
- son livre
"Afin
que nul n'oublie"
- les
mots de
l'association aux obsèques de Gaston Donnat.
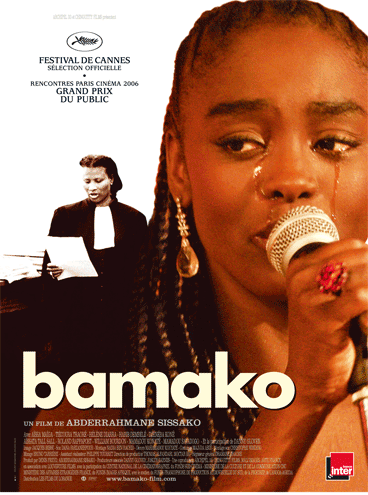 L' ACCA participe
à la diffusion
L' ACCA participe
à la diffusion
et aux débats sur le film.
Qu'elle recommande à tous ses adhérents et amis
avec les mots de
Geneviève Buono.
Cher, très
cher Abderrahmane Sissoko
Du fond du cœur, merci,
merci.
Vous êtes l’honneur
de l’humanité.
En cette époque
cupide, sans pitié, égoïste et morose,
Dont le seul moteur est
l’argent.
Vous avez poussé
votre cri,
Un cri qui
s’épanouit
dans la lumière de l’espérance,
La rose de votre Bamako.
Votre film, par la
puissance généreuse de son intelligence,
tellement
rayonnante qu’elle atteint au sublime,
Est une force
extraordinaire,
Touchante et
vénéneuse.
Et pas seulement pour les
peuples d’Afrique
Car tous, nous sommes des
Africains,
Stupide est celui qui le
sent pas, ne le voit pas,
Tous, nous sommes
confrontés à l’emprise des
multinationales qui mènent
le monde à sa perte et rêvent de notre retour
à
l’état d’esclave.
C’est pour ça que
vivre est difficile -je veux dire vivre sans lutter-
Car tous, il suffit de
s’unir et d’y croire.
Le monde est à
nous, elle est à nous, la Terre,
Oui, Bamako est le film
qu’il faut voir,
Dont notre jeunesse doit
se nourrir,
Partout, à tous, il
faut montrer ces images
Comédiens
animés
d’une inspiration si belle que l’on se demande
s’ils jouent un
rôle ou si ce que vous mettez, cher Abderrahmane, dans votre
boîte est la réalité.
La
vérité. Enfin elle
apparaît,
arrachant les
masques hypocrites de ces tyrans qui mènent le
monde, travestis en bienfaiteurs.
Ce monde est
à nous. Changeons-le ! Unissons-nous. Inversons le
sens
que ces soit-disant décideurs voudraient impulser
à nos
destinées. Construisons un avenir riche de
solidarité
et d’amour du prochain. A bas l’ère du
libéralisme !Vive
le monde des travailleurs libérés, vive la
Terre !
Geneviève BUONO

LDH
TOULON
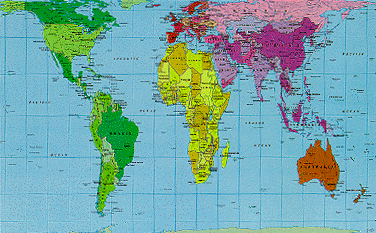
Accueil
l'avenir est aux
peuples ! :

Accueil
Contacter l'ACCA
Pour nous contacter, cliquez ici !
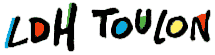
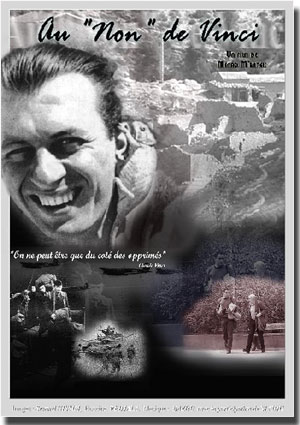


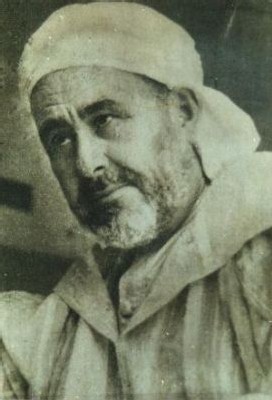
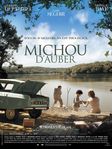


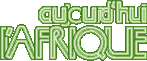

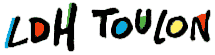
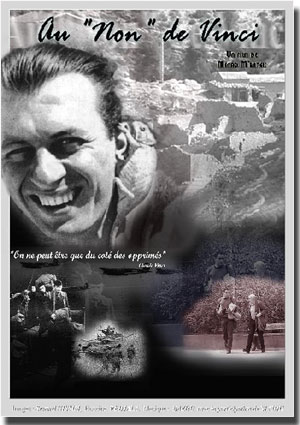


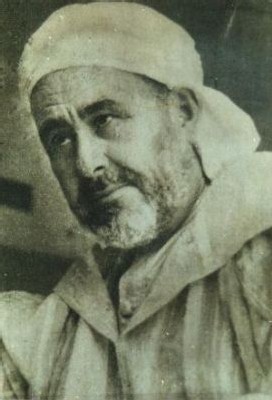
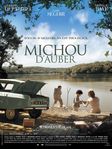





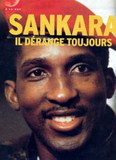
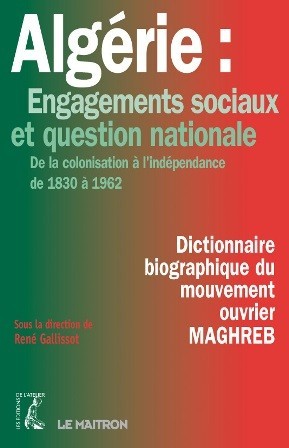

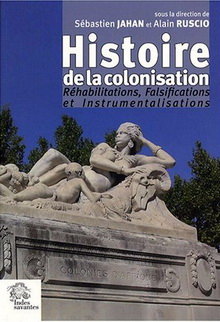
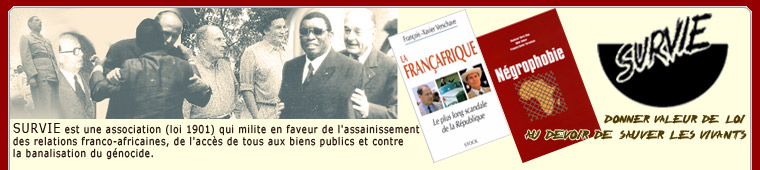




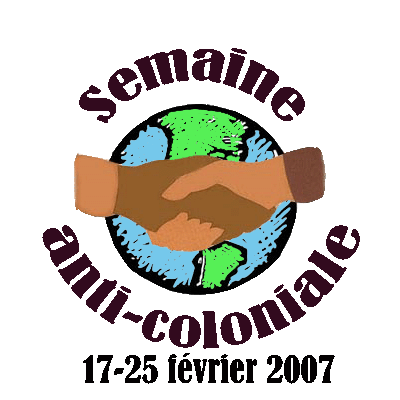
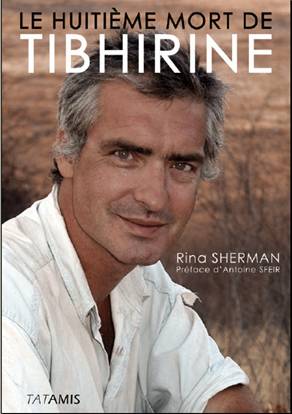 Victime d’une
campagne calomnieuse sans précédent, en
février 2004, le grand reporter Didier Contant fait une
chute mortelle
d’un immeuble parisien alors qu’il
s’apprêtait à publier son
enquête
sur la mort des moines de Tibhirine en Algérie en 1996. Les
résultats
d’un long travail d’investigation sur le terrain
à Blida par l’ancien
rédacteur en chef de l’agence Gamma confirment que
les moines ont été
enlevés et assassinés par le GIA (Groupe
Islamiste Armé).
Victime d’une
campagne calomnieuse sans précédent, en
février 2004, le grand reporter Didier Contant fait une
chute mortelle
d’un immeuble parisien alors qu’il
s’apprêtait à publier son
enquête
sur la mort des moines de Tibhirine en Algérie en 1996. Les
résultats
d’un long travail d’investigation sur le terrain
à Blida par l’ancien
rédacteur en chef de l’agence Gamma confirment que
les moines ont été
enlevés et assassinés par le GIA (Groupe
Islamiste Armé).